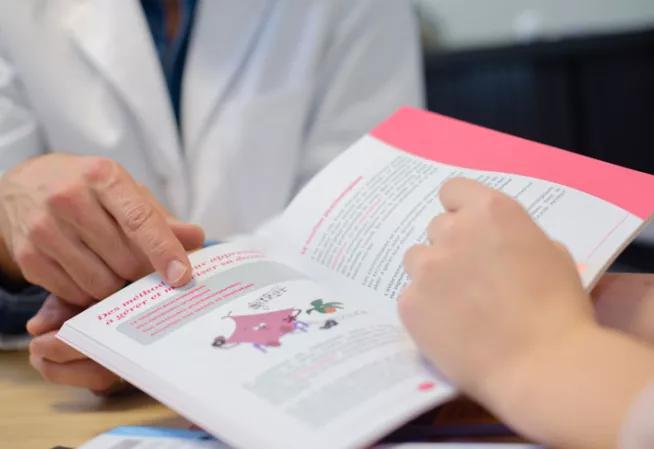Le rôle de l’agence régionale de santé dans la gestion des risques sanitaires liés à l’environnement
Le champ d’intervention de l’ARS en santé environnementale s’organise autour de trois grandes thématiques :
- La prévention et la gestion des risques pour la santé humaine liés à l’eau (protection de la ressource en eau, alimentation en eau potable, légionelles, eaux conditionnées, eaux de baignade, eaux de piscine, etc.)
- La prévention et la gestion des risques dans l’environnement extérieur (impacts liés aux activités humaines passées, présentes et futures, qualité de l’air extérieur, lutte anti vectorielle, musique amplifiée, rayonnements non ionisants, déchets d’activités de soins à risques infectieux, etc.)
- La prévention et la gestion des risques dans les espaces clos (habitat insalubre, amiante, plomb, qualité de l’air intérieur, intoxications au monoxyde de carbone, radon, risques auditifs, etc.)
Les missions en matière de santé environnement au sein de l’ARS
- Contrôle et Inspection en application de la réglementation sanitaire ;
- Expertise lors de l’instruction de dossiers administratifs ou de production d’avis sanitaires basés sur l’évaluation des risques pour la santé ;
- Intervention pour la gestion des situations d’urgence (intoxications au monoxyde de carbone, légionellose, intoxications alimentaires d’origine hydrique, etc.) ;
- Animation transversale des politiques dans le domaine de la santé environnementale (plan régional santé – environnement et ses déclinaisons territoriales notamment dans les CLS)
- Prévention et promotion de la santé par l’information et l’éducation sanitaire.
L’eau, un bien commun à préserver
« L’eau, c’est la vie »
Si l’eau joue un rôle essentiel, tant pour la santé humaine, que pour l’environnement, les activités économiques et sociales ou encore la sécurité et la protection civile, il importe en retour de préserver ce bien commun sur le plan quantitatif et qualitatif et d’adapter ainsi nos usages et nos pratiques.
L’eau du robinet fait l’objet d’une surveillance rigoureuse et régulière. Celle-ci est assurée conjointement par l’ARS, au titre du contrôle sanitaire, et par les collectivités en charge de la production et de la distribution de l’eau (PRPDE), responsables du suivi des installations et de la qualité de l’eau.
L’ensemble de ces acteurs doit relever de multiples défis pour garantir une eau potable de qualité au robinet en permanence. La dégradation des ressources en eau impacte directement la qualité de l’eau distribuée, entraîne une intensification des traitements nécessaires et fragilise la sécurisation de l’alimentation. De plus, les phénomènes météorologiques intenses de ces dernières années - qu’il s’agisse d’inondations ou de sécheresses - rappellent la nécessité de sécuriser encore la résilience de l’alimentation en eau potable. Ces évènements, qui risquent de s’intensifier, soulignent l’importance pour chaque usager, y compris dans nos régions de l’Ouest, de considérer l’eau comme une ressource à la fois précieuse et vulnérable.
Quels sont les rôles de l’ARS et des différents acteurs ?
Le domaine de l’eau potable mobilise de nombreuses parties prenantes (cf. schéma général ci-après), au rang desquelles se trouve prioritairement la Personne responsable de la production et/ou de la distribution de l’eau (PRPDE), désignant toute personne morale (collectivité, entreprise délégataire ou structure spécifique) ou physique (propriétaire unique, exploitant agricole ou particulier) qui met à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de l’eau à des tiers. Cette dernière interagit étroitement avec les maires, garants de la salubrité et de la sécurité publiques.
Les ARS, quant à elles, sont chargées de la sécurité sanitaire des eaux, qu’il s’agisse d’eau de baignade ou d’eau destinée à la consommation humaine. Pour suivre la qualité de cette dernière, les ARS organisent, en collaboration avec les PRPDE :
- La surveillance de la qualité de l’eau émanant du réseau public, selon un programme rigoureux de prélèvements et d’analyses, sur toute la chaîne de production et de distribution de l’eau (de la ressource en eau brute au robinet du consommateur) ;
- L’interprétation des résultats d’analyses, accompagnée de mesures de gestion sanitaire ;
- L’information du public via une synthèse annuelle ;
- L’instruction, pour le compte du préfet, des procédures d’instauration des périmètres de protection, d'autorisation sanitaire, leur suivi administratif ainsi que la gestion des éventuelles procédures de dérogation prévues par le code de la santé publique ;
- L’accompagnement de mesures de prévention et de gestion des risques sanitaires mise en œuvre par les PRPDE, en vue d’assurer la distribution d’une eau de qualité en permanence.
Les mairies et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, de manière complémentaire, actionner des leviers liés à l’aménagement du territoire ou aux plans territoriaux alimentaires, pour concourir à la préservation de la ressource en eau, en particulier au sein des aires d’alimentation des captages d’eaux destinée à la consommation humaine.
Parmi ses différentes missions relevant de la sécurité sanitaire des eaux, l’ARS met en œuvre, en complément du suivi exercé par les PRPDE, un programme rigoureux de prélèvements et d’analyses sur l’ensemble de la chaîne de production et de distribution de l’eau, de la ressource en eau brute jusqu’au robinet du consommateur
Plus d’une soixantaine de paramètres et familles de paramètres font l’objet de ce suivi : il s’agit de paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques.
En Pays de la Loire, le contrôle sanitaire diligenté par l’ARS a été renforcé récemment par l’ajout :
- de nouveaux pesticides et produits de dégradation (métabolites) de pesticides, fin 2024. Pour information, plus de 250 molécules de pesticides sont actuellement suivis.
- des per-ou polyfluoroalkyles (PFAS), depuis janvier 2025.
A savoir : le suivi de la qualité de l’eau évolue
En vue d’assurer une sécurité renforcée de la qualité de l’eau distribuée, sous impulsion de la directive européenne 2020-2184 du 16 décembre 2020, le contrôle sanitaire évolue, avec :
- l’intégration de nouveaux paramètres au contrôle sanitaire, au plus tard au 1er janvier 2026 ;
- l’évolution des exigences de qualité au regard des enjeux sanitaires ;
- la mise en place d’un mécanisme de vigilance sur des paramètres émergents d’intérêt ;
- la limitation des possibilités de dérogation ;
- le renforcement du suivi des produits, matériaux et procédés de traitement de l’eau ;
- l’amélioration des modalités d’information de la population.
La directive européenne et ses textes de transposition renforcent également les obligations de la PRPDE en matière de surveillance des installations et de la qualité de l’eau (cf. arrêté du 30 décembre 2022 et article R1321-23 du CSP).
Pour en savoir plus, consulter l'article sur la qualité de l'eau en Pays de la Loire, rubrique "L'eau : l'aliment le plus contrôlé" : Qualité de l'eau potable en Pays de la Loire.
Les données du contrôle sanitaire sont publiques et accessibles à tous
Les données du contrôle sanitaire sont publiques et disponibles en ligne, notamment sur le site du ministère de la santé, mis à jour de manière continue : Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine|Ministère chargé de la santé.
En complément, afin d’informer les usagers de la qualité de l’eau qu’ils consomment, des synthèses annuelles sont élaborées par l’ARS et portées à la connaissance des abonnés par les PRPDE au moment de la réception de la facture d’eau par l’usager : Accès aux données de Qualité de l'eau potable dans les communes|Fiches Infofactures.
À noter : toute situation de non-conformité associée à une restriction d’usage de l’eau est portée, dès confirmation, à la connaissance des abonnés concernés, par l’intermédiaire de la PRPDE en lien avec le préfet, l’ARS et le maire de la commune concernée.
Zoom sur la qualité de l’eau en Pays de la Loire et focus sur certains paramètres (CVM, PFAS,...)
Plus de 14 000 prélèvements sont planifiés annuellement par l’ARS, au titre du contrôle sanitaire, pour s’assurer de la qualité de l’eau distribuée en région Pays de la Loire. Globalement, l’eau distribuée est de bonne qualité.
Pour en savoir plus, consulter le bilan 2024 de la qualité de l'eau en Pays de la Loire (rubrique "La qualité de l'eau en Pays de la Loire - bilan annuel") : Qualité de l'eau potable en Pays de la Loire.
Le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) est une démarche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau depuis la zone de captage jusqu’au robinet.
Promue par l'OMS, Il s’agit d’une démarche d’amélioration continue basée sur analyse poussée des risques, le développement de plans d'action spécifiques et une surveillance constante.
Les PGSSE comportent trois objectifs prioritaires :
- prévenir et anticiper les risques,
- assurer une qualité continue de l'eau pour le consommateur,
- garantir le respect des exigences réglementaires en tout temps.
Leur mise en œuvre relève de la responsabilité de la PRPDE. Le calendrier fixé par la directrice européenne de 2020 et ses textes de transposition est le suivant : Les PRPDE doivent réaliser la première partie “zone de captage” des PGSSE avant juillet 2027 et finaliser le plan complet avant janvier 2029.
Le changement climatique, au travers de périodes de sécheresse ou d’intense pluviométrie influe sur la quantité disponible mais également sur la qualité des ressources en eau (cyanobactéries, matières organiques, …) et de l’eau distribuée (sous-produits de désinfection, contaminations microbiologiques…) comme.
Face à ces nouvelles contraintes, les collectivités doivent agir le plus en amont possible pour assurer, en tout temps, la production et la distribution d’une eau de qualité répondant aux besoins quantitatifs.
Connaitre et anticiper pour mieux agir, s’inscrire dans une démarche préventive de gestion des risques tout en organisant une réponse adaptée aux situations de crise, sont des priorités pour les collectivités, que le changement climatique vient renforcer.
Boîte à outils :
- Conférence organisée par l'ARS Grand Ouest : Connaître, anticiper et s’organiser face aux défis du changement climatique pour assurer la distribution d’une eau de qualité en tout temps et pour tous #CGLE25 (C44) | Formations idealCO
- L'Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE) a conçu un guide technique et un outil Excel qui recensent les dangers et les mesures de maîtrise des risques. Un addendum règlementaire au guide et une fiche type "résumé de la démarche PGSSE engagée sur le territoire" ont été récemment publiés, à la suite de la transposition de la directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (directive 2020/2184).
Les mairies et présidents d’EPCI peuvent actionner les leviers de l’aménagement du territoire ou des plans territoriaux alimentaires en vue de concourir à la préservation durable de la qualité de la ressource en eau.
Protection des ressources en eau et urbanisme
Les SCoT et PLU(i) sont des documents de planification qui jouent un rôle essentiel dans la résilience des territoires et dans leur adaptation au changement climatique. Ils permettent également d’identifier les secteurs les plus sensibles, dont font partie les ressources en eau, en vue d’adapter en conséquence les aménagements et travaux possibles.
Concernant la protection des ressources en eau potable vis-à-vis des pollutions anthropiques, deux dispositifs complémentaires existent :
- les périmètres de protection des captages (PPC) rendus obligatoires depuis la loi sur l’eau du 03/01/1992 au titre du code de la santé publique (ARS) visent principalement les pollutions ponctuelles et accidentelles, Etablis sur la base d’études hydrogéologiques, ils comprennent plusieurs niveaux de protection (et de servitudes associées) : un périmètre immédiat, obligatoire et acquis par la collectivité en pleine propriété, où seules sont possibles les activités en lien direct avec la production d’eau potable ; un ou des périmètre(s) rapproché(s) au sein desquels sont interdits ou réglementés certains travaux, installations, et activités. Ils peuvent être complétés par un périmètre éloigné ( zone de vigilance) ;.
- les aires d’alimentations des captages (AAC) au titre du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales.
En Pays de la Loire, plus de 98% des captages et ressources en eau destinée à la consommation bénéficient d’un arrêté préfectoral fixant pour chaque périmètre de protection des captages (PPC) les servitudes de protection opposables aux tiers par déclaration d’utilité publique (DUP).
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. À ce titre, elles ont vocation à être annexées aux plans locaux d’urbanisme et s’imposent par ce biais aux autorisations d’occupation du sol (permis de construire…).
Dans l’attente de l’opérationnalité du Géoportail de l’urbanisme, les informations relatives aux périmètres de protection des captages d’eau (délimitation des périmètres concernés et servitudes) sont consultables au lien suivant : Une cartographie interactive des captages d'eau potable et de leurs périmètres de protection | Cart'Eaux (sur inscription).